Pourquoi la fornication (zina) est-elle également interdite aux femmes n’ayant plus leurs menstrues ?, par Abdessamad Dialmy
- --
- 13 janvier 2016 --
- Opinions
Le tabou de la virginité, ou la nécessité pour la jeune fille de s’abstenir sexuellement, est un tabou qui remplit une fonction contraceptive dans le système islamo-patriarcal comme je l’ai avancé depuis 2012. C’est en effet ce tabou qui fait éviter à la famille la naissance d’enfants illégitimes susceptibles de créer la confusion dans les lignées et dans la transmission des biens. Et c’est la raison principale pour laquelle l’islam a interdit la fornication (zina) à la jeune fille. De la femme mariée, l’islam a exigé la fidélité car le coït interrompu (comme seule méthode contraceptive connue, pratiquée et légalisée dans le cadre du mariage) était peu sûre, que ce soit hors mariage ou dans le cadre du mariage.
Pour détruire cette thèse, certains m’ont rétorqué (lors de la célébration du 24ème anniversaire de la mort d’Aberrahim Bouabid organisée par la Fondation Abderrahim Bouabid le 8 janvier 2016, et focalisée entre autres sur le thème des valeurs et des libertés) que l’islam interdit la fornication même à la femme ménopausée qui ne craint plus de tomber enceinte. Par conséquent, la base de l’interdit de la fornication ne saurait s’expliquer selon eux par la nécessité d’éviter les grossesses hors mariage.
Ce contre-argument ne tient pas pour la simple raison que la notion de ménopause était inconnue lors de la révélation coranique, et encore moins par les foqaha. En effet, il a fallu attendre le début du 19ème siècle pour la voir apparaître avec Charles Gardanne, un médecin français. La ménopause, cette notion descriptive, se situe dans le contexte de la naissance de l’embryologie scientifique qui a découvert l’ovule (Karl Ernst von Baer) au début du 19ème siècle également. Découverte capitale qui montre que la femme n’est pas un simple réceptacle receveur.
Avant cette date, et pendant des millénaires de patriarcat, on a pensé que l’homme déposait son sperme dans l’utérus et que ce sperme devenait progressivement à lui seul, un être humain, sans aucun apport féminin. La femme-enceinte n’était donc qu’un réceptacle porteur (hamil) de quelque chose qui ne lui appartenait pas et qui appartenait à l’homme (d’où l’octroi du nom du père à l’enfant/patronyme/système patrilinéaire). La femme est comme la terre, labourée par l’homme, appartenant à l’homme. Leurs fruits respectifs appartiennent à l’homme.
Avant cette ère patrilinéaire et patriarcale, quand le rôle du sperme n’était pas connu dans la fécondation, l’enfant appartenait au clan de la mère qui tombait enceinte suite à l’insufflation de l’esprit d’un ancêtre du clan de la mère, d’où un système social matrilinéaire.
Pour les foqaha et pour la société patriarcale qui partageaient la même ignorance générale en matière d’ovulation et de ménopause, la fin définitive des menstrues ne signifiait nullement que la femme ne pouvait plus tomber enceinte. Elle ne signifiait pas l’âge du désespoir (سن اليأس), celui du désespoir définitif de tomber enceinte. Ils ne connaissaient pas la notion de ménopause car cette notion n’existait pas. Pour eux, tant que la femme recevait du sperme, elle pouvait encore tomber enceinte, malgré la fin définitive des menstrues.
C’est pour cela que l’interdit de la fornication était compris et interprété par eux comme devant englober également la femme qui n’avait plus de menstrues. Celles-ci n’étaient pas perçues comme une étape antérieure au processus de l’ovulation (également inconnu). Les menstrues étaient uniquement craintes (perte de sang) et rejetées comme période d’activité sexuelle parce qu’elles représentaient un risque d’expulsion du sperme reçu, c’est à dire la perte d’un capital précieux servant à rendre les membres de la famille, de la tribu et la Umma plus puissants parce que plus nombreux. Le nombre faisait la force.
En un mot, il faut distinguer entre deux notions : celle la perte définitive des menstrues et celle la ménopause. La première notion, empirique, conduisait à affirmer que la femme sera toujours en risque de grossesse en cas d’activité hétérosexuelle même si elle n’a plus ses règles. La seconde, scientifique, signifie que la fin définitive des règles et de l’ovulation met fin au risque de grossesse même en cas d’activité hétérosexuelle.
Par conséquent, on ne peut pas détruire l’interdit de la sexualité comme contraception dans le cas de la jeune fille en exploitant son extension au cas de la femme ménopausée. Cette extension est scientifiquement illégitime dans la mesure où la fin définitive des menstrues n’était pas considérée comme l’indicateur de la fin d’un cycle menstruel, comme l’indicateur d’une infertilité définitive.
En conclusion, les jeunes filles, les divorcées et les veuves (en âge de reproduction) ainsi que les femmes ménopausées non mariées, ont un droit (humain) à la sexualité, droit qui ne peut leur être dénié par crainte d’une grossesse « indue » qui trouble (rait) l’ordre social. Dans le cas des jeunes filles, des divorcées et des veuves en âge de reproduction, les méthodes contraceptives modernes permettent une sexualité protégée du risque de toute grossesse involontaire. Dans le cas des femmes ménopausées, aucune contraception n’est nécessaire en cas d’activité hétérosexuelle.
La cause principale de l’interdit islamique de la sexualité hors mariage est donc désormais caduque: l’intention islamo-patriarcale de préserver la pureté de la lignée et l’honneur (al ‘ird العرض) est protégée par les moyens de contraception modernes (dans le cas des femmes non mariées en âge de reproduction) et par la ménopause (dans le cas des femmes qui ne sont plus en âge de reproduction). L’accessibilité universelle aux contraceptifs est un droit humain que les pouvoirs public tentent de garantir. Leur effort est à saluer. Cet effort ne saurait aboutir sans l’abrogation de l’article 490 du code pénal afin que les rapports sexuels entre adultes consentants soient reconnus comme droit humain fondamental : une fois reconnus, ces rapports seront assumés, et alors mieux protégés de tout ce qui n’est pas plaisir et jouissance, c'est-à-dire des risques inhérents à la sexualité.
---------------------------
Le Professeur Abdessamad Dialmy est Docteur d'Etat, Professeur d'Université et sociologue de la sexualité, du genre et de la religion. Il est l'auteur d'une quinzaine d'ouvrages sur la sociologie de la sexualité, les femmes et le féminisme au Maroc et dans le monde arabe.





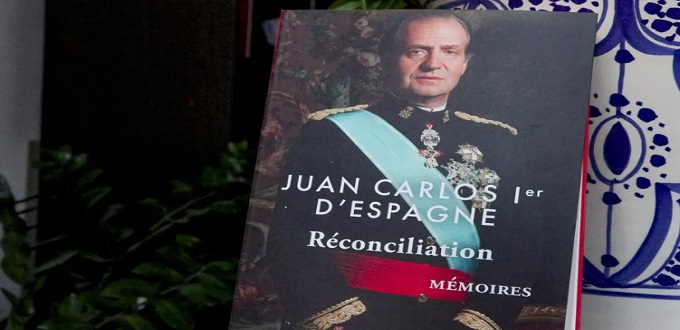










Commentaires