
Le nouvel ordre mondial : unipolarité affirmée ou illusion transitoire ?
- --
- 19 août 2025 - 11:00 --
- Opinions
Les propos tenus récemment par Donald Trump, affirmant que l’idée d’un monde à pôles multiples s’est effacée et qu’il ne subsiste désormais qu’un seul pôle dirigeant la planète, témoignent de la persistance d’une lecture hiérarchique des relations internationales. L’image qu’il choisit, celle de huit États assis comme des élèves devant un maître, traduit une volonté politique autant qu’elle constitue une métaphore de la position américaine dans l’ordre global. Cette représentation n’est pas anodine : elle réactive l’idée du « moment unipolaire » décrit au lendemain de la guerre froide et cherche à réaffirmer la centralité des États-Unis dans un monde traversé par des recompositions multiples.
L’unipolarité, telle qu’elle s’est imposée après 1991, reposait sur la convergence de plusieurs facteurs : la supériorité militaire des États-Unis, leur domination économique, l’avance technologique et l’influence culturelle. Charles Krauthammer fut l’un des premiers à théoriser ce « moment unipolaire » en insistant sur l’absence de rival systémique. D’autres, comme Joseph Nye, ont élargi la réflexion en soulignant que la puissance américaine ne tenait pas seulement à ses capacités matérielles mais aussi à sa capacité d’attraction, qu’il désigna sous le terme de soft power. L’hégémonie post-guerre froide a donc été autant une affaire de force que de séduction. Mais très vite, des voix comme celle de Samuel Huntington ont rappelé que cette suprématie susciterait des résistances identitaires et civilisationnelles, annonçant déjà les lignes de fracture qui allaient traverser l’ordre mondial.
La rhétorique trumpienne s’inscrit dans une autre logique. Elle ne cherche pas à masquer l’asymétrie, ni à habiller la domination d’un discours universaliste, mais assume pleinement l’idée d’un centre unique et d’une hiérarchie verticale. L’image des États assis en silence devant le maître traduit une pédagogie autoritaire : les puissances, même celles qui disposent d’une autonomie régionale, sont invitées à accepter la centralité américaine sans contestation. Le discours s’inscrit dans la continuité de la doctrine « America First », qui substitue à l’internationalisme libéral un rapport brutal de force et de loyauté contrainte.
Pourtant, la scène internationale ne se laisse pas réduire à ce schéma unipolaire. L’émergence de la Chine, avec son projet des Nouvelles Routes de la soie et sa montée en puissance technologique, contredit toute vision d’une suprématie américaine incontestée. La Russie, en dépit de ses difficultés structurelles, continue d’imposer ses choix stratégiques, que ce soit en Syrie ou en Ukraine, révélant la persistance de pôles de résistance. Les BRICS, élargis récemment à de nouveaux membres, traduisent aussi une volonté croissante de construire des alternatives économiques et diplomatiques. Loin de disparaître, la multipolarité s’affirme, même si elle reste encore désordonnée et incomplète.
L’évocation par Trump de villes comme Mossoul, Ninive ou Bagdad possède une charge symbolique forte. Ces lieux furent, à différentes époques, des centres impériaux où se décidaient les équilibres régionaux et mondiaux. Leur mention rappelle que l’histoire de la domination ne se réduit jamais à une ligne continue mais se compose de cycles de puissance, de gloire et de déclin. Bagdad, au moment de sa chute en 2003, représentait le sommet de la puissance américaine ; mais elle fut aussi le lieu où se révélèrent les limites de cette domination, incapable de se traduire par un ordre stable et durable. Cette mémoire impériale, réactivée par le discours politique, souligne que toute hégémonie est par essence fragile et éphémère.
Le nouvel ordre mondial qui se dessine ne peut donc être réduit ni à une unipolarité consolidée, ni à une multipolarité déjà aboutie. Il se situe dans un entre-deux instable : d’un côté, une puissance américaine qui continue de disposer d’atouts incomparables et cherche à imposer son récit d’un monde hiérarchisé ; de l’autre, une pluralité d’acteurs émergents qui contestent ce récit, sans pour autant parvenir à imposer une vision alternative cohérente. Ce paradoxe fait de notre époque un moment charnière, où se mêlent l’illusion de la permanence et les signes du changement. Comme l’a montré Immanuel Wallerstein dans sa théorie des systèmes-monde, ces phases de transition sont souvent les plus instables, car elles traduisent une tension entre la force d’une structure dominante et les dynamiques qui œuvrent à son dépassement.
Le discours de Donald Trump révèle moins une photographie fidèle de l’ordre mondial qu’une tentative de restaurer une image de puissance incontestée. Mais l’histoire de Mossoul, de Ninive et de Bagdad rappelle qu’aucun empire n’est éternel et que toute hégémonie finit par rencontrer ses limites. Le nouvel ordre mondial apparaît ainsi non comme un retour définitif à l’unipolarité, mais comme un champ de tensions où s’affrontent récit hégémonique et réalités multipolaires. C’est dans cet espace mouvant que se joue l’avenir de la gouvernance internationale.
Par Omar Lamghibchi





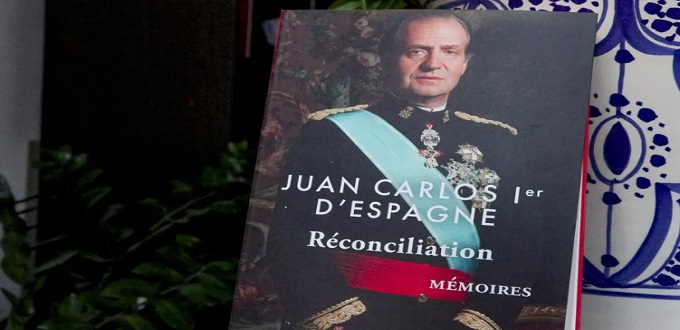









Commentaires