
« Et si l’Afrique émergente était une fable ? », par François Giovalucchi
- --
- 17 septembre 2018 --
- Opinions
« L’Afrique émerge ! » Au fil d’ouvrages destinés au grand public, de rapports administratifs, d’études de think tanks et d’interviews de faiseurs d’opinion, un raisonnement simple et globalisant s’est diffusé, sans les précautions et réserves qui parsèment le discours des annonciateurs les plus subtils de l’émergence. Une vulgate assimilée par de nombreux décideurs, des chefs d’entreprise aux gouvernants, sous le regard au mieux sceptique mais le plus souvent amusé, voire consterné, des gens de terrain et des africanistes.
Ce storytelling peut ainsi se résumer : l’Afrique connaît une croissance soutenue ; selon la vieille rhétorique administrative, sa population jeune et croissante est un défi, mais avant tout une chance ; la technologie, où ses entrepreneurs excellent, lui permettra de brûler les étapes du développement ; des classes moyennes émergent et se ruent dans les centres commerciaux. L’Afrique constitue donc la nouvelle frontière de l’économie mondiale.
On se plaît ainsi à rêver d’un start-up continent comme on rêve d’une start-up nation : les récentes retrouvailles de la France et du Rwanda ont eu lieu à l’occasion d’un salon consacré aux jeunes pousses de l’économie. Plus prosaïquement, en léninistes qui s’ignorent, les chantres de l’émergence africaine imaginent compenser les tendances lourdes au ralentissement de nos économies par la recherche de débouchés exotiques.
Des investissements pharaoniques
 Et pourtant… Avec la crise des matières premières de 2014, la croissance africaine s’est fortement ralentie, voire est devenue négative dans certains pays. Elle a été le plus souvent tirée par un endettement public à mauvais escient. La population des Etats dont les recettes budgétaires se sont effondrées avec la chute des cours est gravement affectée par la réduction imposée des dépenses. Le service de la dette s’envole.
Et pourtant… Avec la crise des matières premières de 2014, la croissance africaine s’est fortement ralentie, voire est devenue négative dans certains pays. Elle a été le plus souvent tirée par un endettement public à mauvais escient. La population des Etats dont les recettes budgétaires se sont effondrées avec la chute des cours est gravement affectée par la réduction imposée des dépenses. Le service de la dette s’envole.
L’industrialisation ne progresse guère et certains Etats sont au contraire frappés par une désindustrialisation précoce. Les rendements agricoles stagnent ou régressent. Les anciennes filières d’excellence (café, caoutchouc, coton, palmier à huile…) sont marginalisées sur les marchés internationaux. Cette crise africaine n’est donc pas comparable à la crise asiatique de la fin des années 1990, d’origine largement financière et ne reflétant pas le défaut d’évolution structurelle des économies.
Au-delà des analyses, les élites qui font fuir leurs capitaux comme les jeunes désespérés qui cherchent à émigrer à tout prix ou rejoignent les mouvements djihadistes et diverses guérillas, montrent chaque jour leur peu de foi en l’avenir radieux qu’on nous dépeint.
Dès lors, on est fondé à s’interroger sur les raisons du succès du discours de l’émergence. L’enjeu n’est pas mince. En Afrique, ce discours est devenu le registre de légitimation des démocratures prédatrices, comme le développement l’était pour les régimes autoritaires de l’après-indépendance. Il a constitué l’alibi d’investissements pharaoniques souvent surfacturés. Au Nord, il a été à l’origine de prêts et d’investissements internationaux risqués, dont les citoyens et les salariés pourraient supporter les conséquences, maîtrise de la dépense publique et rentabilité des entreprises obligent.
Un récit imaginaire et édifiant
Loin de nous l’idée de faire un procès d’intention à ceux qui ont porté ce discours. Leurs motivations paraissent variables, allant de l’illusion amoureuse envers un continent propre à susciter les passions, à des stratégies de positionnement politique personnel, en passant par la tentative d’énonciation d’une fiction performative : si l’Afrique est dite émergente, les investisseurs s’y précipiteront et l’émergence se concrétisera.
Le discours de l’émergence africaine répond aux canons de la fable, entendue comme récit imaginaire et édifiant : les raisons de son succès sont d’ordre idéologique.
En premier lieu, le discours prospère car il annonce une bonne nouvelle. L’Occident, pour qui « les lumières du futur s’en sont allées », selon l’image de l’historien François Hartog, est rassuré de voir que l’histoire d’un continent jusque-là perçu comme résistant à la vision européenne de la modernisation s’inscrit désormais dans une téléologie salutaire. Il permet d’afficher une confiance de bon aloi en la capacité des sociétés tierces à suivre la voie occidentale et, en contrepoint, de disqualifier les contradicteurs en leur prêtant de troubles arrière-pensées.
Le discours de l’émergence confirme aux gouvernants français que la défense d’une place particulière sur le continent ne relève pas d’une quelconque nostalgie impériale, mais au contraire d’un choix visionnaire. Il justifie que l’aide française ait été, jusqu’à une date très récente, axée sur les prêts et non les dons : l’Afrique est « bankable ». Enfin, le discours de l’émergence, poussé à son terme, peut justifier des politiques d’immigration restrictives : pourquoi migrer d’un continent plein d’opportunités ?
Citoyen réduit à l’état de consommateur
Surtout, le discours est en résonance avec la pensée aujourd’hui dominante, que certains qualifieront de néolibérale. Ce discours est caractérisé par le déni du politique. Que de très nombreux régimes africains soient focalisés sur leur survie à court terme, que la « politique du ventre » axée sur l’exploitation de rentes (matières premières, aide internationale…) soit incompatible avec les arrangements socio-institutionnels comparables à ceux passés en Asie du Sud-Est entre pouvoirs et investisseurs, on n’en dit mot.
Jusqu’à récemment, le politique était pris en compte dans une version appauvrie, via l’appel à la bonne gouvernance comme clé de la performance économique. Franchit-on une nouvelle étape inquiétante où la prédation n’est plus jugée contre-productive ? Par ailleurs, le citoyen africain est réduit à l’état de consommateur à qui l’on dénie une capacité à penser son avenir, comme au citoyen de la start-up nation réduit au rôle d’utilisateur de plateforme.
L’entrepreneuriat est mythifié à grands coups de célébrations de rares success stories, en omettant que la supposée appétence des jeunes Africains pour la création d’entreprise – généralement rapidement suivie d’échec, d’où le peu d’empressement des banques pour les accompagner – relève le plus souvent de la débrouille et du pis-aller, faute d’accès à des emplois stables.
La technologie est érigée en fétiche. Dans une déclinaison hypertrophiée jusqu’à l’échelle continentale du « solutionnisme technologique » raillé par Evgeny Morozov, elle est perçue comme une panacée, sans réflexion sur les conditions sociopolitiques de son déploiement. Des exemples supposés illustrer l’avancée technologique de l’Afrique, comme la percée du mobile banking au Kenya, sont ressassés ad nauseam. La solution magique de la numérisation n’a pas empêché la baisse de la productivité des banques africaines sur la période récente, mais on l’omet. Dans d’autres domaines, des échecs cuisants comme les tentatives de scolarisation par tableau numérique sont pudiquement oubliés.
Foi dans la révolution technologique
Une classe moyenne aux contours flous et au nombre artificiellement gonflé par un revenu plancher fixé par la Banque africaine de développement au seuil ridiculement bas de 2 dollars par jour est montrée en exemple des bienfaits de la mondialisation. Que les classes moyennes occidentales fragilisées et les fonctionnaires du Sud déclassés par les politiques d’ajustement structurel en prennent de la graine !
Partout, la prospérité d’un discours pour le moins contestable reflète la place croissante des « savoirs » produits hors de l’université et ne répondant pas à ses exigences, mais validés par le marché. Mais c’est à Paris que la fable de l’émergence a eu les avocats les plus zélés et la plus forte audience. Le discours tenu dessine, à la mode du moment, les nouveaux contours de la relation franco-africaine. Le rétablissement du commerce extérieur remplace le rêve de grandeur ; la foi dans la révolution technologique et le marché tient lieu de valeurs à partager. L’illusion du lien privilégié et la réalité des intérêts particuliers en arrière-plan demeurent.
--------------------------
François Giovalucchi est diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris (IEP) et titulaire d’un DEA d’économie et finances internationales de l’université Paris X. Il a occupé divers postes de responsabilité en France et à l’étranger, à Direction générale du Trésor et à l’Agence Française de Développement (AFD) pour le compte de laquelle il a travaillé 17 ans en Afrique.





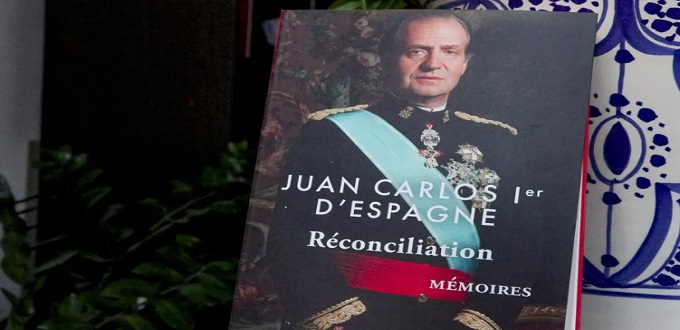










Commentaires