
Le doctorat fait-il encore rêver ? Regards croisés entre le Maroc et la France
Lorsqu’ils posent auprès de leur jury pour une photo souvenir de leur soutenance de thèse, les candidats au doctorat affichent en général un sourire radieux. Mais au-delà de ce moment symbolique, le doctorat n’a rien d’un long fleuve tranquille. Si les sacrifices pour décrocher ce diplôme sont importants, ses perspectives interpellent aussi dans la mesure où le marché de l’emploi se corse. Une situation que l’on éclairera à partir des situations dans deux pays, le Maroc et la France, sans forcément les mettre en comparaison.
Inscriptions en doctorat
Au Maroc, si l’adoption du système LMD depuis le début des années 2000 a certainement facilité l’accès au doctorat, le nombre de diplômés à bac +8 reste relativement faible. En 2017, seulement 1937 personnes ont décroché un doctorat. Rapporté aux chiffres de la population, cela équivaut à un taux de 0,5 néo-docteur pour 10 000 habitants.
Les inscriptions en thèse n’inversent pas la donne. Les doctorants ne représentent que 4,2 % des étudiants. De quoi soulever des inquiétudes quand on sait qu’entre 2015-2020, pas moins de 1 000 enseignants partiront en retraite. Il s’agit de la génération, en majorité formée en France, qui a posé les bases des universités actuelles. La question de la relève en nombre et en qualité est préoccupante.
En France, si l’on a enregistré une baisse de 10 % des inscriptions en thèse entre 2012 et 2016, les soutenances restent sur un rythme de 10 000 chaque année. La réticence des étudiants est-elle due au risque d’échec ? C’est pourtant l’inverse que révèlent les résultats d’une étude : 41 % des doctorants ont soutenu leur thèse en moins de 46 mois en 2014, contre 31 % l’année précédente. Les chances de réussite vont crescendo, ce qui peut être expliqué entre autres par l’amélioration des conditions de réalisation de la thèse.
Structures d’accueil
Pour les doctorants marocains, les difficultés commencent dès la recherche d’une structure d’accueil. 60 % des doctorants ne sont affiliés à aucun laboratoire. L’accès à la bibliographie et au matériel de recherche est un combat. Les conséquences sont accablantes : 9 thésards boursiers sur 10 jettent l’éponge au milieu du chemin. Ceux qui font preuve de résistance ne connaissent pas un meilleur sort : 80 % vont soutenir leurs travaux sans avoir produit la moindre publication.
L’encadrement des travaux de recherche est une autre défaillance dans la vie des docteurs marocains. Face à l’explosion du nombre d’étudiants liée à la croissance démographique (rappelons que le nombre d’habitants a progressé de 10 millions en 10 ans, tandis que les jeunes représentent 28 % de la population), les universités ont dû accueillir 820 488 étudiants en 2017 alors que leur capacité d’accueil n’est que de 512 630 places. Les professeurs sont débordés. Dans certains cas, ils se retrouvent à diriger plus de 40 travaux de recherche à la fois.
En France, outre le nombre de laboratoires de recherche, un autre facteur de succès est la variété de l’offre de financement. Entre allocations ministérielles, bourses de mobilité et contrats de recherche, 69 % des doctorants français ont obtenu un financement au titre de l’année de 2014. Ces contrats sont liés à des objectifs de recherche que les doctorants doivent s’appliquer d’atteindre pendant la durée de leurs thèses. Le renouvellement des bourses tient compte de la réalisation de ces objectifs. Les doctorants avouent que la période de renouvellement des bourses est vécue avec autant de stress que la période de préparation des soutenances.
Ceci dit, certaines disciplines concentrent plus d’intérêt de la part des organismes de financement. Le taux de financement en sciences dites exactes est de 96 % en première année contre 38 % en sciences humaines et sociales. En l’absence de financement, les doctorants de ces branches sont obligés de mettre la main à la poche : 29 % d’entre eux exercent des activités rémunérées.
Force est de dire que le coût financier engendré par un projet doctoral est toujours considérable. Au Maroc, les offres de financement sont très rares et pour la plupart attribuées par le ministère de l’Enseignement supérieur.
Insertion professionnelle
L’insertion professionnelle des nouveaux docteurs est compliquée, qu’il s’agisse du Maroc ou de la France. L’enseignement est bien sûr le premier choix des néo docteurs. Le rêve de décrocher un poste après la thèse ne se réalise pas immédiatement. En France, 60 % des nouveaux docteurs sont obligés de passer d’abord par des emplois provisoires à durée déterminée – contrats post-doctorat et ATER (Attachés temporaires d’enseignement et de recherche).
La concurrence est très rude en France et nombre de docteurs finissent par aller voir ailleurs : 40 % des docteurs en lettres et sciences humaines et sociales s’orientent vers l’enseignement secondaire et primaire. Certains vont même travailler dans des postes sans aucun lien avec l’enseignement et la recherche dans les administrations nationales et territoriales.
Au Maroc, les universités manquent cruellement d’enseignants mais l’État s’est engagé dans des plans de baisse des charges publiques dicté par les institutions financières internationales. Les universités privées viennent étoffer le paysage au Maroc, malgré qu’elles soient décriées par certaines voix qui accusent l’État de vouloir privatiser le service public. Les docteurs leur tournent le dos et ne le considèrent dans la majorité des cas comme des tremplins. La charge de travail plus élevée, l’absence de possibilités d’évolution, le peu de temps consacré à la recherche sont les principales causes de la réticence des néo docteurs.
Les débouchées en privé sont pour l’heure timides au Maroc et en France. Il s’agit d’abord de la volonté des docteurs qui, après avoir eu le goût des cours, des communications et des expériences en laboratoires, ne se projettent pas dans un autre métier. L’adéquation entre les spécialités des docteurs et les besoins des entreprises est une autre question. Si les ingénieurs et les docteurs en économie et gestion sont les profils les plus demandés au Maroc, ils ne constituent que 7 % des doctorants.
Nabil Ouarsafi
Enseignant chercheur en management à l'Université Hassan 1er, Université Hassan Ier – AUF





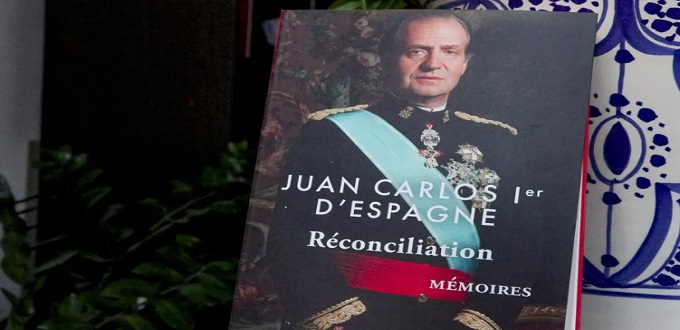










Commentaires