
Facebook, Google : les "hérétiques de la Silicon Valley" nous alertent
- --
- 15 décembre 2017 --
- Opinions
Remords, prise de conscience ? On commence à voir plusieurs cas d'anciens cadres de géants du numérique qui alertent sur le rôle négatif que joue leur ancienne entreprise sur nos sociétés.
Dernier en date, Chamath Palihapitiya, ex-vice-président en charge de la croissance de l'audience de Facebook, qui a assuré : « Je pense que nous avons créé des outils qui déchirent le tissu social ».
« Immense culpabilité »
Venant de celui qui était chargé d'attirer toujours plus d'inscrits sur Facebook, les propos, filmés et diffusés par The Verge, ont suscité l'attention. Car il ne dit pas seulement que l'utilisation de Facebook contribue à saper le tissu social, mais aussi que les gens sont « programmés », qu'ils le perçoivent ou non.
Selon lui, « cette merde érode les fondements du comportement des gens ». Faisant part de son « immense culpabilité », il a affirmé qu'il utilisait le moins possible Facebook et qu'il interdisait à ses enfants de l'utiliser, recommandant à son public de faire « une vraie pause » avec les réseaux sociaux.
Du coup, Facebook s'est fendu d'une réponse directe. L'entreprise se défend en déclarant :
« Chamath n'est plus à Facebook depuis plus de six ans. Quand il y était, nous étions concentrés sur la création de nouvelles expériences de réseau social, et sur la croissance de Facebook dans le monde. Facebook était une entreprise très différente à l'époque, et comme nous avons grandi nous avons pris conscience de ce que nos responsabilités ont grandi aussi ».
Soulignant travailler avec des experts extérieurs et des chercheurs, Facebook affirme « nous voulons réduire notre profitabilité pour nous assurer que les bons investissements sont réalisés » ; un écho à la déclaration de Mark Zuckerberg en novembre, « Protéger notre communauté est plus important que maximiser nos bénéfices ».
« On ne peut pas faire confiance à Facebook… »
Le mois dernier, un autre ancien du réseau social, Sandy Parakilas, ex-"operations manager" du réseau social en 2011 et 2012, lançait un brûlot dans le "New York Times" en affirmant qu'on ne peut pas faire confiance à Facebook pour s'autoréguler.
Ce qui faisait d'autant plus mal que Facebook, comme Google et Twitter, est mis sur le grill ces temps-ci par les parlementaires américains à propos de l'ingérence russe dans la campagne présidentielle de 2016.
Sandy Parakilas déclare notamment :
« J'ai dirigé les efforts de Facebook pour réparer les problèmes de vie privée sur sa plateforme pour développeurs, avant son introduction en Bourse en 2012 », expose Parakilas. « Ce que j'ai vu de l'intérieur, c'était une entreprise qui donnait la priorité à la collecte de données sur ses utilisateurs avant leur protection contre des abus. Alors que le monde se demande que faire avec Facebook en découvrant son rôle dans l'ingérence électorale russe, il doit considérer cette histoire. Les législateurs ne devraient pas autoriser Facebook à s'autoréguler. Parce qu'il ne le fera pas ».
Là aussi, le réseau social s'est défendu sur le thème « nous avons changé et les critiques viennent de quelqu'un qui n'est plus chez nous depuis des années ».
Tout aussi virulent, Sean Parker, qui a été le premier président de Facebook (créateur de Napster, il a été un des premiers actionnaires du réseau social), a tenu, lui aussi en novembre, des propos assassins sur la création de l'addiction chez les utilisateurs.
« Une vulnérabilité dans la psychologie humaine »
Dans une interview à Axios, il a souligné que Facebook a été conçu pour exploiter la façon dont les individus pensent et se comportent. « Cela change littéralement votre relation avec la société, les uns avec les autres ». Pour lui, l'addiction est inhérente au réseau social, où obtenir des likes ou des commentaires fait un effet similaire à celui de la dopamine : Parker a pointé du doigt la nature addictive de Facebook qui pousse un grand nombre d'entre nous à revenir.
Pour l'investisseur, l'addiction tient à la nature même du service, conçu à cette fin. Ainsi recevoir un "like" ou un commentaire à son message fonctionne comme la dopamine : « C'est une boucle d'approbation sociale ... exactement le genre de choses qu'un hacker comme moi pourrait trouver, parce que vous exploitez une vulnérabilité dans la psychologie humaine ».
En octobre déjà, Justin Rosenstein, dans le "Guardian", a expliqué comment il s'est maintenant fortement restreint dans son usage des réseaux sociaux. Précision importante : cet informaticien de 34 ans est l'homme qui a créé le bouton "j'aime", ou "like", dans Facebook...
« Un internet pour répondre à l'économie de la publicité »
Le quotidien britannique parle dans le même article d'un groupe « petit mais grandissant d'hérétiques de la Silicon Valley, qui se plaignent de la montée de la soi-disant 'économie de l'attention' : un internet formé pour répondre à l'économie de la publicité ».
Le "Guardian" souligne :
« Ces refuzniks sont rarement des fondateurs ou des PDG, qui ont peu intérêt à dévier du mantra selon lequel leurs compagnies font du monde un endroit meilleur. Ils tendent plutôt à être un ou deux rangs plus bas dans l'échelle de l'entreprise : des designers, des ingénieurs et des responsables produits qui, comme Rosenstein, ont mis en place il y a plusieurs années les briques d'un monde numérique dont ils essaient maintenant de se dépêtrer eux-mêmes. 'C'est très courant, dit Rosenstein, que des humains développent des choses avec les meilleures intentions et qu'elles aient pour eux des conséquences négatives non désirées’ ».
L'exemple le plus abouti peut-être de ces "refuzniks" est Tristan Harris, auteur d'un manifeste, « Comment la technologie pirate l'esprit des gens ». Cet informaticien, ancien "philosophe produit" chez Google pendant trois ans, a créé avec James Williams, un autre ancien de Google, le label Time Well Spent ("du temps bien dépensé").
Avec pour objectif de lancer le débat sur la manière dont les technologies nous manipulent, « accaparant notre attention, notre temps, nos choix... de manière à nous faire rester le plus longtemps possible sur leurs interface. […] Ils veulent montrer que de plus en plus, les technologies, en plus d'être chronophages, décident pour nous. Que les téléphones, les applications, sont devenus une forme de compétition avec la réalité », écrivait Rue89-L'Obs en 2016.
D'aucuns répondront classiquement « il suffit de ne pas les utiliser ». Sauf que, souligne Tristan Harris cité par Internet Actu :
« Le problème est que ce qui est important pour l’utilisateur est lié à ce qui est important pour l’entreprise : 'La machine sur laquelle vous perdez votre temps est aussi celle que vous utilisez pour savoir si votre enfant est malade, vous ne pouvez donc pas l’éteindre ou la laisser derrière vous.' Pour Harris, nos machines ne cessent de développer de nouvelles manières de nous persuader, nous faisant passer d’une transe l’autre ».
En 2004, la formule du patron d'alors de TF1, Patrick Le Lay, faisait scandale : « Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible ». En 2017, plus personne ou presque n'est choqué de ce que nos applis dévorent notre attention, et partant notre temps. Ces "hérétiques de la Silicon Valley" sont-ils des avant-gardistes ou arrivent-ils trop tard ?
Ces patrons tech qui refusent l'écran à leurs enfants
On pense au passage à l'attitude de ces dirigeants de géants du numérique : Steve Jobs est souvent cité en exemple, qui interdisait iPhone et iPad à ses jeunes enfants, mais d'autres patrons de la tech font de même, envoyant par exemple leurs rejetons dans des écoles sans écrans.
Certes, objecteront certains, ces pros n'auront peut-être pas besoin de l'école pour initier leurs enfants à la technologie et au numérique. Mais que ceux qui mènent l'expansion tous azimuts de la tech retardent l'accès aux écrans de leurs propres enfants, c'est pourtant loin d'être anodin ; n'avouent-ils pas ainsi leur propre méfiance devant les dangers d'une hyper-connexion ?
Thierry Noisette, dans tempsreel.nouvelobs.com





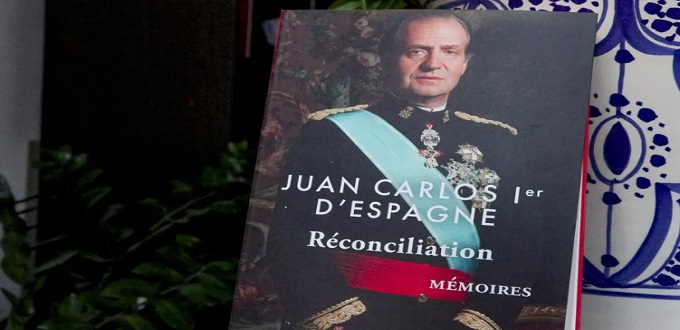










Commentaires